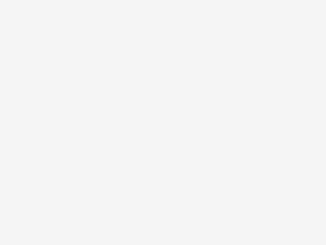REPORTAGE – Les enfants apprennent l’arabe mais aussi une seconde langue, souvent le français, afin de pouvoir rejoindre les écoles publiques du pays.
Envoyée spéciale dans l’Akkar
Une clameur enjouée résonne aux abords d’un campement posé au fond d’un champ d’orangers. À l’intérieur d’une fragile tente chauffée par le soleil, une douzaine d’enfants récitent en chœur l’alphabet arabe. Alya, 4 ans, aime se faire entendre. Originaire de Homs en Syrie, sa famille est arrivée il y a cinq ans dans le camp de Wadi El Jamous, dans l’Akkar, au nord du Liban. Elle n’a donc jamais connu son pays d’origine et ne comprend d’ailleurs pas qu’on lui demande d’où elle vient. «Ben, d’ici!», répond-elle en pointant le reste du camp. Comme les autres élèves de cette classe dite «informelle», Alya n’apprend pas seulement l’arabe. Pour qu’ils aient la possibilité de rejoindre le cursus classique des écoles publiques du Liban, à partir de 7 ans, les réfugiés syriens doivent se familiariser avec une seconde langue, puisque les maths et les sciences ne sont traditionnellement pas enseignées en arabe. Pour Alya et ses amis, c’est le français. Saisons, jours de la semaine, météo, parties du corps humain: les posters affichés sur les cloisons de la tente sont dans la langue de Molière qu’ils apprennent depuis septembre. La comptine «Tourne, tourne, petit moulin», qu’ils entonnent avec une fierté, figure déjà dans leur répertoire.
Pour assurer les cours, à hauteur de 3 heures par jour, quatre jours par semaine, une jeune femme du camp a été choisie et formée par l’ONG irlandaise Concern Worldwide, présente depuis 2013 au Liban. À l’extérieur de la tente, les parents des élèves – une petite communauté de 75 personnes qui vit là depuis trois ans – devisent à l’ombre d’un soleil printanier. «Nous pensons au futur, explique le chawich (chef de la communauté). Nous ne voulons pas que nos enfants soient élevés comme nous, illettrés. Il faut qu’ils aient une meilleure éducation.» Ces enfants, issus de milieux ruraux et défavorisés, n’auraient pas forcément été régulièrement à l’école en Syrie. En dehors des cours, beaucoup travaillent dans les champs alentour pour ramener un peu d’argent. «C’est souvent le chawich qui décide qui doit travailler, même si ce sont des enfants» explique Farah al-Omar, qui supervise les programmes scolaires pour Concern. Un aîné de la communauté le confirme avant de se raviser, embarrassé d’avoir évoqué un secret de polichinelle.
200.000 enfants sans accès à l’éducation
Plus haut dans la montagne, dans le village reculé de Fneideck, le petit Mahmoud, 12 ans, n’a pas cette gêne. Arrivé il y a trois ans d’Hama, il est l’unique «actif» de la famille: son père est un blessé de guerre et il n’a que des petites sœurs. Alors, comme son camarade Hassan qui lave des voitures, il travaille pour nourrir sa famille. Le garçon a trouvé un emploi de berger, «de l’aube au crépuscule» dans cette région frontalière froide où les hyènes se promènent en hiver. «Je ne savais même pas que je pouvais aller à l’école ici. Je l’ai appris par le bouche-à-oreille. Au début, mes parents n’étaient pas trop d’accord, et puis, ils ont accepté tant que je continue à faire le berger entre les cours et le week-end», raconte-t-il, avant de réciter une phrase en français, qu’il étudie depuis février. «J’aimerais être apprécié pour ce que je fais.»
Sur le chemin de l’école, Mahmoud raconte qu’il se fait souvent racketter «toujours par la même famille» qui lui dérobe ce qu’il a gagné en gardant le troupeau. Aujourd’hui, il suit des cours de remise à niveau dispensés par des institutrices syriennes et locales, pour espérer rejoindre le cursus libanais. Le ministère de l’Éducation a en effet mis en place des cours l’après-midi réservés aux Syriens (les Libanais suivent ceux du matin). Malgré cet aménagement, le système est mis à rude épreuve pour accueillir 200.000 élèves supplémentaires. Ils sont tout autant à n’avoir accès à aucune forme d’éducation au Liban, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux diverses formes de violence et aux mouvements radicaux qui prospèrent dans les zones frontalières.
Mais ce phénomène n’est pas seulement lié à la saturation extrême de l’enseignement public. Il tient aussi au manque d’informations, de sécurité sur le chemin de l’école (trajets nocturnes, chaotiques, mal éclairés), à la cherté des transports, au travail des enfants, mais aussi aux mariages précoces. «Dans les écoles publiques, les femmes mariées ne sont pas acceptées. Or, on rencontre des jeunes syriennes mariées à 15 ans et même parfois dès 12 ans», explique Farah al-Omar. Pour ces jeunes filles, des «ateliers vocationnels» sont organisés afin de leur apprendre la coiffure, le crochet, le tricot, ou le maquillage. Autant de petits boulots qu’elles peuvent exercer au sein de leur communauté, et qui leur permettent de se resociabiliser, à défaut, ou en attendant, d’avoir à nouveau des perspectives d’avenir. Avec l’insouciance de ses 4 ans, la petite Alya a, elle, une idée très claire de son futur: elle entend continuer à aller à l’école pour devenir «Madame», c’est-à-dire institutrice.